A l’heure où les 18 organisations signataires du “Pacte progressiste sur la fin de vie“ , initié par l’ ADMD et la MGEN, se contentent visiblement de ne demander la possibilité de l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie que pour les personnes en fin de vie “atteintes d’une maladie grave et incurable” ,
ce “fait divers” ( relaté dans l’ Obs ) d’une personne de 87 ans qui est contrainte de se suicider par une méthode violente, alors qu’elle n’est pas atteinte d’une “maladie grave et incurable”,
montre à l’évidence que la transformation législative très restreinte proposée par ces 18 organisations ne répondra pas à toutes ces situations où des personnes ont de très bonnes raisons personnelles de vouloir mettre fin à leur vie, mais ne pourront pas trouver un moyen légal de “mort douce”, et seront ainsi encore contraintes de recourir à des méthodes de suicide dont le cas relaté est un parfait exemple.
Comment ces 18 organisations peuvent-elles prétendre, dans le point 3 de leur “Pacte progressiste” que :
“Il importe qu’en France, chaque personne ait le droit et puisse réellement décider et faire respecter son libre choix de parcours de vie jusqu’au bout. »
( Ce que nous partageons bien sûr à Ultime Liberté )
et en même temps, dans la phrase précédente limiter ce droit par une ” légalisation d’une aide active à mourir pour les personnes atteintes d’une maladie grave et incurable qui, en conscience et librement, la demanderaient” ?
Il est très clair, pour l’association Ultime Liberté, qu’un texte législatif véritablement “progressiste” ne saurait limiter le “respect du libre choix d’une personne” à la condition stricte d’être atteinte d’une maladie grave et incurable.
A moins, par exemple, de décider d’appeler “pathologie grave et incurable” l’ ensemble du “syndrome” de la vieillesse …, ce qui n’est probablement pas l’interprétation donnée par le “Pacte progressiste”.
Nous préparons donc, au C.A., une lettre ouverte à destination de ces 18 organisations, pour leur poser la question de ce qui nous semble être une contradiction manifeste entre l’intention générale affichée de libre choix et les restrictions de “pathologie grave et incurable” mises à ce choix.
Une façon habituelle de “dégager en touche” , connue depuis le fameux “ils n’ont qu’à se suicider” de Jean Leonetti, qui voulait par là justifier les restrictions de la loi de 2016 à la seule “sédation profonde et continue”, c’est de dire que les personnes qui ne pourront pas bénéficier d’une Aide Active à Mourir ( “médicale” ) , ont toujours encore le “choix” de se suicider, puisque le suicide n’est pas pénalisé ……
Les nombres exemples de suicides violents de personnes âgées, non atteintes de pathologies graves et incurables, montrent que les restrictions proposées pour une nouvelle législation par le “Pacte progressiste” ne sont pas tenables, si on est vraiment convaincu qu’il s’agit de faire respecter le “libre choix du parcours de vie” d’une personne.
Le 29 mars 2023
Armand Stroh,

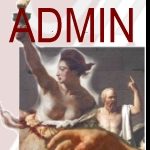

2 commentaires sur ““Libre choix de son parcours de vie”, vraiment ?”
Mais qu’appellent ils “pathologies graves” ??? La perte d’autonomie est une pathologie grave et encore aggravée par la situation misérable de nos Ehpads. On y meurt à petit feu cruellement, sauf très très rares exceptions. L’enfer…
Le terme de “pathologie” utilisé dans ce cadre est synonyme d’ atteinte, soit par une maladie proprement dite, soit par un accident traumatique entraînant des lésions corporelles, de l’ état de santé d’une personne. Dans les deux cas, l’examen diagnostique de la situation “pathologique” , donc le constat de l’ existence effective soit d’une maladie, soit de lésions traumatiques ( par exemple du système nerveux ), est considéré très largement comme relevant de compétence scientifiques particulières, sur lesquelles la médecine , comme pratique technique, doit s’appuyer. Une grande partie de la formation des compétences médicales est liée à une formation minimale à différents champs de connaissance scientifique de la biologie humaine.
Il s’agit bien sûr ici toujours d’atteintes à l’ “état de santé” corporel d’une personne individuelle.
L’extension de l’usage du terme de pathologie pour englober également un certain nombre d’ aspects des troubles mentaux ou “psychologiques” reste dans la même définition d’un trouble individualisable, et même de plus en plus attribuable aux spécificités du fonctionnement cérébral de cette personne.
C’est ce qui entraîne la problématique d’une extension de l’accès légal à l’euthanasie ou au suicide assisté pour la raison de “pathologie grave” aux pathologies neurologiques ou psychiatriques ou encore aux polypathologies du grand âge, pour autant que la capacité de discernement de la personne, nécessaire à la libre détermination de sa volonté de mourir, soit préservée.
L’extension du terme de “pathologie” que vous suggérez à des situations sociales ou économiques, en proposant par exemple que la “perte d’autonomie” soit considérée comme une “pathologie grave et encore aggravée par la situation misérable de nos EHPAD “, pose le problème de l’ extension du terme de “pathologie”, du niveau de la personne individuelle, plus ou moins atteinte par la “pathologie” en question, à un niveau de lien social plus large que la personne individuelle :
C’est alors l’ensemble de ces liens , familiaux, sociaux, culturels, communicationnels, relationnels, supra-individuels, que vous allez considérer comme éventuellement “pathologiques” .
Dans ce cas, il est évident que les problèmes importants à traiter ne peuvent plus se situer uniquement au niveau de “pathologie grave individuelle” dont le degré de gravité pourrait ou non justifier la liberté de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté, mais posent la question politiquement encore bien plus difficile de savoir ce que seraient des relations sociales, économiques, culturelles, ou un tissu relationnel ou un milieu de vie “pathologique”, non pas seulement parce qu’ils entraîneraient statistiquement plus que d’autres environnements l’apparition de pathologies individuelles proprement dites ( diagnostiquées médicalement ), mais parce qu’elles seraient en soi des formes sociales, culturelles , politiques, juridiques, économiques, etc. “pathologiques” .
Ce ne sont alors évidemment pas des considération “médicales” qui peuvent prétendre qu’un fonctionnement familial, social, politique, économique, culturel, etc. serait “pathologique” , que la “société” serait malade, et qu’il faudrait “soigner” tel ou tel aspect de la “pathologie politique” ou de la pathologie sociale , économique , etc.
Certes la métaphore de la pathologie est couramment utilisée , y compris en politique pour considérer que telle ou telle forme de pensée politique ou d’idéologie est “pathologique” et chacun pense aujourd’hui avoir son mot à dire pour soigner notre “démocratie malade” , car chaque citoyen a une représentation personnelle ou communautaire de ce que serait une “société en bonne santé” , et de ce que seraient des traits supposés “pathologiques” de la société.
Certains pensent d’ailleurs que, comme au niveau de la médecine scientifique basée sur une science biologique , on devrait pouvoir définir des sciences sociales, des sciences politiques et économiques, voire une science écologique générale, qui pourraient décrire des “pathologies” par rapport à des “états de santé” normaux d’une société … et ainsi proposer des remèdes “technocratiques” provenant de l’ accord des spécialistes compétents de toutes ces disciplines du “collectif” … en se passant ainsi du débat proprement “démocratique” fondé sur l’ égalité et la liberté de citoyens beaucoup moins “compétents” …
En conclusion : SI nous voulons, dans notre association Ultime Liberté, étendre la liberté du choix de mourir au-delà des cas proprement diagnostiqués comme “pathologies graves” au sens médical individuel, ce n’est pas en cherchant à étendre la notion de “pathologie grave” à d’autres situations pénibles ( et notamment en transformant la volonté de se suicider elle-même en “pathologie” … ) que nous allons faire reconnaître juridiquement la liberté du choix de mourir.
Mais c’est bien en posant une autre voie, directe, de reconnaissance juridique de cette liberté, comme liberté fondamentale reconnue à des citoyens et personnes libres et égales par ces citoyens eux-mêmes en instituant leur commune “loi de liberté”.
Les personnes qui veulent se reconnaître mutuellement une telle liberté le feront, tôt ou tard, et créeront librement leur propre collectif politique et juridique, si nécessaire, peu importe que d’autres considèrent que ce projet politique et juridique est – à leurs yeux – “pathologique”, et prétendent avoir la “compétence” de définir ce qui est politiquement et juridiquement “pathologique” et ce qui ne l’ est pas.
Car dans ce domaine où la liberté se déploie en créant ses propres institutions politiques et juridiques, chaque personne qui reconnaît l’ Égale Liberté des autres peut participer à la formation de la “volonté générale” instituant ou même constituant le cadre politique et juridique de régulation de leur commune “Égale Liberté”.
Il ne tient donc qu’à chacun de nous de savoir jusqu’où il acceptera de reconnaître la liberté des autres de choisir leur propre vie et leur propre mort, s’il veut qu’en retour ces “autres” puissent reconnaître politiquement et juridiquement la sienne.
Tant qu’une personne veut une liberté radicale pour elle-même, mais ne veut pas se poser la question de savoir comment d’ autres qu’elle-même peuvent également vouloir jouir de cette même liberté, il n’y a pas de “protection” collective possible à attendre d’une telle “loi de protection de la liberté du choix de mourir”, et la “liberté” en question, à défaut d’ être garantie comme “liberté conventionnelle” reconnue par chacun, dépendra de la “liberté réelle” que chaque personne est capable ou non, dans le réel concret de sa situation, de se “garantir” à elle-même. ( Une “liberté réelle” par définition aussi inégalitaire que le sont les conditions de vie et ressources réelles de chaque personne … )